Article publié dans Sexualités humaines, Revue de santé sexuelle et de sexologie des professionnels de santé, n°36, janvier-mars 2018.
La notion de diversité sexuelle est un jalon important dans la libéralisation des attitudes sociales vis-à-vis de la sexualité. Cet article se propose d’explorer quelques unes des tensions théoriques et pratiques qu’implique une certaine conception contemporaine de cette diversité. Il propose une analyse de la notion d’« intérêt sexuel », qui sous-tend le concept de paraphilie, et formule l’hypothèse que c’est autour de cette notion, en apparence descriptive, que se recompose un ensemble de normes psychosexuelles contemporaines, en deçà du discours psychopathologique.
L’idée que les comportements sexuels sont essentiellement divers ou qu’il leur est naturel de varier, donnée à la fois culturelle, historique et neurobiologique, est un jalon important de l’histoire de la sexologie. Formellement, ce qui varie dans le comportement concerne les mœurs sexuelles et le comportement relatif au sexe (contraception, conjugalité…), mais plus particulièrement les modalités de l’obtention du plaisir.
Lorsqu’elles commencent à être décrites par la psychiatrie au milieu dans les années 1850, les manifestations non coïtales, non hétérosexuelles de la sexualité, témoignant de penchants profondément ancrés chez l’individu, sont attribuées à un état de dégénérescence du système nerveux. Dans ce modèle, l’érotisation d’activités s’éloignant ou ne concourant pas à un coït satisfaisant sur le plan psychosexuel doit faire supposer un état psychopathologique, qu’on en souffre ou non, et qu’elles portent ou non préjudice à autrui.
On peut donc comprendre le processus de normalisation des anciennes « perversions », initié au début du XXe siècle, comme un déplacement du principe de leur diversité : d’abord, elles sont autre chose que des formes prises par un même trouble mental (la perversion) ; et en parallèle, elles réintègrent le spectre naturel, sain et normal de l’érotisme, et quittent stricto sensu le champ de la psychopathologie. Le sadisme, le masochisme, le fétichisme, etc. seront par exemple aujourd’hui plus volontiers décrits comme des aspects de l’érotisme ordinaire (approche sexologique), des tendances érotiques fondamentales (psychanalyse), se rencontrant régulièrement dans la population générale (statistique et sociologie), y compris chez des personnes en bonne santé, dans d’autres cultures et au travers de l’histoire. Dans le même temps, on assiste à une purification du vocabulaire psychopathologique, qui met à distance les connotations négatives de la déviance pour embrasser la terminologie des « paraphilies », neutre au point de vue normatif. Cette épuration culmine avec la distinction récente entre « paraphilie » et « trouble paraphilique » dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (2013) : la première est une simple spécificité de « l’intérêt sexuel », qu’il est possible d’ « établir », la seconde est un authentique trouble mental, accompagné de symptômes cliniques, qu’il est possible de « diagnostiquer ».
Or malgré ce mouvement de distanciation entre ce qui relève de la particularité et ce qui relève de la psychopathologie, la perception contemporaine de la diversité sexuelle partage beaucoup d’éléments avec l’espace conceptuel de la perversion fin de siècle – beaucoup plus en tous les cas que ne semble l’admettre une certaine relecture contemporaine de l’histoire de la sexologie. Cet héritage concerne les catégories dans lesquelles sont ressaisies les pratiques.
Avant que la psychopathologie ne décrive des « perversions sexuelles », la nature des fantasmes entrant en jeu dans l’excitation et la satisfaction sexuelle n’étaient pas les éléments saillants de la compréhension de la sexualité. En classifiant les maladies de l’instinct sexuel, la psychopathologie n’a par exemple pas à proprement parler pathologisé des comportements « auparavant immoraux », ou porté un regard médical sur un domaine « auparavant moral ». Il n’a jamais était spécifiquement condamnable de ressentir une excitation sexuelle en manipulant des bottines de cuir ou en recevant des pets, comme c’était par contre spécifiquement le cas pour des plaisirs hors mariage. Le découpage entre pratiques licites et illicites, morales et immorales, normales et pathologiques fonctionne dans des registres différents.
Penchants, tendances, intérêt érotiques particuliers : cette diversité-là ne préexiste pas logiquement à la catégorie de perversion sexuelle, mais en découle. Le discours psychopathologique qui nomme et répertorie les manifestations morbides de l’érotisme est aussi en train de dessiner de nouvelles catégories du discours sur la sexualité, et recompose la diversité des érotismes autour d’une seule variable : le domaine des orientations et des préférences sexuelles.
Des intérêts suspects
Il est notable que l’analyse contemporaine du comportement érotique mais aussi son évaluation sur un axe normatif passe par l’examen des conditions de l’excitation sexuelle et de « l’intérêt sexuel » porté à certaines activités. Le concept d’orientation sexuelle, issu du démembrement de « l’inversion sexuelle » du XIXe siècle, s’applique généralement au genre du partenaire sexuel et affectif. La notion d’intérêt ou de préférence sexuelle admet quant à elle une infinité de variables, étant donné la variété des conditions dans lesquelles surviennent l’excitation sexuelle et la satisfaction.
Les critères du diagnostic de trouble paraphilique font régulièrement l’objet de commentaires et de critiques. Mais quid des critères pour « établir » un intérêt sexuel « paraphilique » ? Si l’on suit les critères du DSM, cet intérêt doit être « intense et persistant », ce qui le différencie des intérêts ponctuels, passagers ou transitoires. Il doit aussi être sexuel, c’est-à-dire impliquer l’excitation, le plaisir ou la satisfaction sexuelle, et la recherche d’activités propres à les procurer, ce qui le différencie d’un intérêt qui serait purement « théorique ». Ce qui veut dire qu’il doit a minima engager des pensées et des sentiments sexuellement excitants, qu’ils débouchent ou non sur des pratiques réelles. Enfin, cet intérêt sexuel peut concerner des activités réelles ou fantasmées.
Formulons l’hypothèse que c’est autour cette notion d’« intérêt sexuel », en apparence descriptive, que se recompose un ensemble de normes psychosexuelles contemporaines, en deçà des normes psychopathologiques. La persistance de l’idée même d’intérêts sexuels « paraphiliques » suppose en effet de les distinguer des intérêts sexuels « normophiliques », et de rendre intelligible la diversité interne des paraphilies. Si d’après le DSM certaines paraphilies seulement sont déviantes, les paraphilies n’en restent pas moins toutes para-normales, regroupées sous ce même mot-parapluie, alors même que le critère de leur cohérence – la commune déviation par rapport à une norme – devient de plus en plus flou. La diversité des formes n’est pas tant éparpillée que redistribuée éventail d’intérêts sexuels possibles, qui est à la fois descriptif et normatif (ils ne sont pas une « stimulation génitale ou [d]es préliminaires avec un partenaire humain phénotypiquement normal, sexuellement mature et consentant », ainsi que l’indique le DSM V).
Diversités ou diversification des plaisirs ?
La notion contemporaine de diversité sexuelle valorise au fond plus volontiers les pratiques occasionnelles du couple monogame que les sexualités paraphiliques à proprement parler. L’inquiétude persistante quant à la frontière entre sexualité dysfonctionnelle et simple « jeu » sexuel est parlante. Le modèle relationnel et interpersonnel de la santé sexuelle tolère voire encourage les jeux érotiques entre adultes consentants, et ont largement pénétré les représentations médiatiques de la sexualité. Mais quid d’une pratique socialement taboue (scatophilie, infantilisme…) devenant le la de la vie sexuelle ?
Sans qu’il s’agisse d’un critère diagnostique, et tout en restant dans le registre de l’innocuité, il est commun de distinguer cliniquement plusieurs niveau d’intensité de l’intérêt sexuel : les paraphilies « optionnelles » où l’activité sexuelle intensifie l’excitation sexuelle, les paraphilies « préférentielles », où le sujet préfère cette activité aux activités sexuelles « normales », mais s’y engage quand même, et les paraphilies « exclusives », où l’activité paraphilique est nécessaire et suffisante pour l’excitation et la satisfaction sexuelle. Ce dernier cas implique donc l’impossibilité de jouir sans l’excitation paraphilique, et l’impuissance physique et/ou psychique à performer le coït. De fait, la préférence pour l’activité paraphilique et le délaissement d’activités normophiliques reconstituent peu ou prou le concept de perversion sexuelle, décrit par la psychopathologie sexuelle de la fin du XIXe siècle.
L’idée n’est pas tant de valoriser la variété des préférences sexuelles, que d’encourager à varier les plaisirs – ce qui revient à ériger la diversité en norme psychosexuelle, puisque la spécialisation voire l’hyperspécialisation de l’excitation sexuelle est vue comme suspecte. La richesse d’une vie sexuelle bien remplie, plutôt que la multiplication d’intérêts sexuels pauvres et restreints. Les paraphilies seraient alors plus acceptables si elles constituent un aspect de la sexualité, plutôt que sa forme principale.
Même sans soupçon psychopathologique, la préférence sexuelle reste compréhensible à l’intérieur de l’approche sexologique comme une limitation de l’expérience sexuelle, une faiblesse qu’il est souhaitable de résorber. Le fétiche enfermerait par exemple dans une façon de jouir exclusive, un scénario unique et donc par définition pauvre, qu’il serait bon d’enrichir en explorant de nouvelles façons de stimuler son désir sexuel. Il en va au fond de même pour la masturbation ou l’activité fantasmatique. Bien que cette dernière soit actuellement reconnue comme une importante composante sexodynamique plutôt que fustigée pour ses dangers, sa prédominance dans la vie sexuelle ne semble pas compatible avec les critères de l’épanouissement sexuel. De même, si l’activité masturbatoire n’est plus la source d’une « panique morale », la combinaison de la masturbation et de la pornographie en ligne forment un tableau sexologique d’une sexualité incomplète, non relationnelle et centrée sur soi. Pourtant, ces deux activités n’enfreignent ni la norme du consentement, ni la limite du préjudice à autrui. Leur point commun est d’affaiblir la possibilité d’une intersubjectivité et le rapport à l’altérité, c’est-à-dire à l’autre réel ou symbolique.
Les pratiques « paraphiliques » sont également négativement associées à une sursollicitation de l’imaginaire et de la masturbation, à la pornographie, notamment en ligne, au recours à la prostitution et aux partenaires multiples. On peut dès lors s’interroger sur les raisons de la persistance d’une inquiétude sociale, et sur son envers psychosexuel normatif : la rencontre physique de deux partenaires, engagés dans une relation affective. Quelle meilleure définition du plaisir pris au sein d’un couple monogame qui, s’il n’a plus pour norme principale de procréer, n’en reste pas moins la principale grille d’intelligibilité du bon sexe ?
Des sexualités « culturellement anormales »
Si l’on évacue les troubles paraphiliques, les troubles de la personnalité et les agressions sexuelles, les sexualités atypiques devraient n’être socialement redevables à personne. Elles n’enfreignent pas la loi, ne causent aucun dommage ni tort à autrui… Mais n’en restent pas moins « bizarres », c’est-à-dire, littéralement : difficiles à comprendre en raison de leur étrangeté, s’écartant voire questionnant l’ordre habituel de la chose. Et de fait, ce « sexe bizarre » heurte les représentations sociales et culturelles du sexe, tout comme il décloisonne des notions habituellement conçues comme descriptives de la sexualité. Ainsi la notion de rapport sexuel, qui peut prendre des formes infinies, loin voire très loin de l’intromission génitale (porter des vêtements, être contraint, éclater un ballon de baudruche…), et n’est donc pas toujours un rapport physique. Ainsi également la notion de partenaire, qui n’existe parfois pas à proprement parler, du moins pas au sens d’une « personne avec laquelle on a une relation sexuelle ».
Au-delà, les formes infinies des pratiques non conventionnelles ou bizarres décloisonnent les frontières habituelles de l’érotisme, de ce qui doit ou non être érotisé, source et objet de pratiques sexuelles. Les paraphilies se situeraient alors essentiellement en dehors des prescriptions culturelles, scénarios indiquant ce qui doit ou ne doit pas être excitant, et qu’elles fonctionnent dans des scripts sexuels différents de ceux socialement acceptés, déroutants pour cette raison (« Comment trouver cela excitant ? C’est répugnant/ridicule »…).
Le caractère inhabituel ou bizarre de certains désirs peut justement être déstabilisant pour la personne qui les expérimente, pour le/la/les partenaires, et ainsi engendrer des comportements d’évitement, de repli masturbatoire, une mésestime de soi, de la culpabilité… Des symptômes comme l’anxiété ou les difficultés relationnelles peuvent donc être uniquement liés aux attitudes sociales et à l’intériorisation du stigmate. La libéralisation des attitudes sociales relatives à la sexualité favorise mais n’engendre pas mécaniquement le bonheur ni la fierté.
Santé sexuelle pour tou.te.s
Il n’est donc pas souhaitable que les anciennes perversions sexuelles disparaissent des radars de la santé sexuelle et mentale, au prétexte qu’elles ne sont pas des pathologies. Cette question met au défi les professionnels de forger des outils pour aborder les érotismes socialement tabous dans leurs diversités, non pas malgré, mais avec leur caractère non conventionnel. Sur le plan de la conjugalité, le polyamour, par exemple (le fait d’entretenir ouvertement et honnêtement des relations amoureuses et/ou affectives avec plusieurs partenaires), relativement bien intégré au paysage sexologique contemporain, est mêlé à des questionnements inintelligibles dans un schéma monogame (exclusivité/adultère), qu’il est donc contre-productif de convoquer comme norme psychoaffective. Or, comment aborder l’impuissance, la frustration, la performance ou tout simplement le plaisir, sans les ressaisir dans les catégories et les normes du coït et de la conjugalité, c’est-à-dire sans remettre en question l’existence d’un intérêt sexuel qui s’en écarte ?
On peut penser qu’il s’agit d’un enjeu marginal, car il n’existe aucune demande de la part des adeptes du sexe bizarre. Mais il n’y a aucune raison de douter que les personnes ayant des intérêts sexuels non conventionnels soient tout aussi (voire plus) susceptibles de rencontrer des difficultés sexuelles et psychologiques. Or, comment leur demande serait-elle reçue ?
Depuis la fin des années 1980, en Amérique du nord principalement, des organisations de promotion de la liberté sexuelle tentent de sensibiliser les professionnels aux sexualités alternatives, et recense les expériences discriminantes vécues par leurs adeptes. La Coalition nationale pour la liberté sexuelle (NCSF), regroupant des organisations BDSM (Bondage/Discipline, Domination/Soumission, Sadisme/Masochisme), échangistes et polyamoureuses,, enrichit ainsi une liste de professionnels et notamment de thérapeutes sensibilisés aux sexualités alternatives (« kink aware »), et garantissant des espaces safe, c’est-à-dire sécurisants et bienveillants, pour ce public. Parmi ses principes fondamentaux : accepter que les intérêts sexuels de leurs patients ne font pas partie du problème à traiter.
Il s’agit en somme de faire valoir que ces pratiques et identités peuvent figurer sur le spectre d’une sexualité saine et normale, et constituer un mode de vie viable et fonctionnel. Et que la diversité des sexualités ne concerne pas uniquement des modes d’excitation et de satisfaction sexuelle – donnée partiellement observable – mais des vies singulières, des trajectoires individuelles et collectives. Elles sont le pivot de nouvelles formes de sociabilité, et de communautés capables de revendiquer d’autres modèles érotiques, mais pas seulement. Il s’agit aussi de valoriser des modes de vie alternatifs et des subcultures (codes et vocabulaire communs, rassemblements plus ou moins fermés), une certaine philosophie et une certaine éthique, relatives mais non restreintes aux rapports sexuels.
Quelle place les professionnels de santé sexuelle et mentale peuvent-ils occuper dans le processus de normalisation des intérêts sexuels atypiques, bizarres, ou non conventionnels ? S’agit-il dans ce processus de normalisation, de « faire devenir normal » ou de « rendre conforme à une norme » ? L’apport des recherches en sciences humaines (psychologie sociale, études culturelles…), est ici décisif. Ces recherches constituent une nourriture solide pour l’approche sexologique, qui depuis l’origine s’est construite de manière transversale et pluridisciplinaire.
Pour citer cet article : « Quelles normes pour quelle diversité sexuelle ? », Tiffany Princep, in Sexualités humaines, Revue de santé sexuelle et de sexologie des professionnels de santé, n°36, janvier-mars 2018

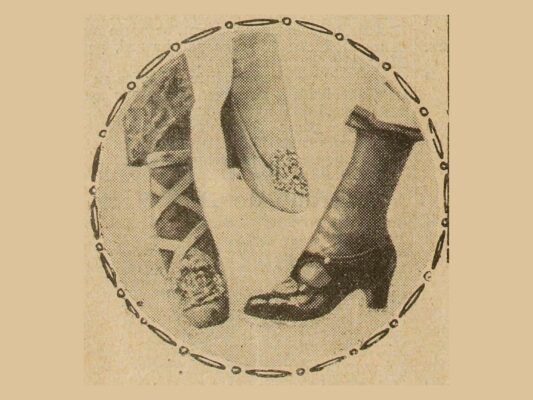

![[Extrait] Chèvres et petits pékinois lécheurs de moule](https://mademoisellealaderive.fr/wp-content/uploads/2022/09/Les_animaux_vivants_du_monde...Cornish_Charles-BNF-651x400.jpg)